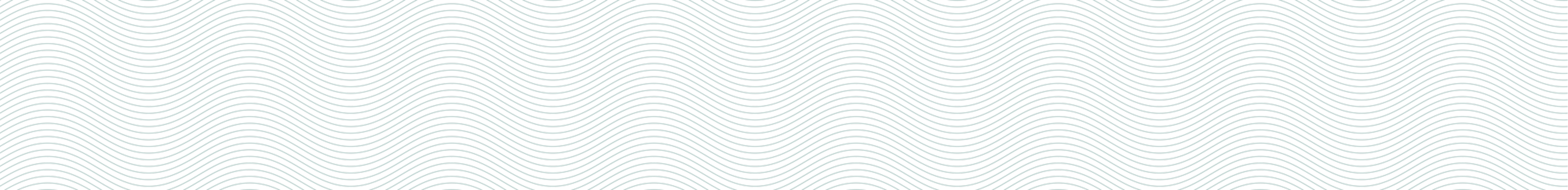L’argile n’est pas une terre mais une roche fractionnée en milliards de minuscules particules. Présente partout sur la planète, elle est le premier remède des animaux qui se ruent vers elle pour se soigner. Mais elle a aussi été utilisée par les humains à des fins thérapeutiques, de tout temps et sur les cinq continents. On appelle d’ailleurs géophages les êtres vivants qui mangent de la terre, car elle contient très souvent de l’argile. Accessible, polyvalente et redoutablement efficace, elle est présente dans la nature et vous aide à vous soigner. Merci à Raymond Dextreit, Michel Rautureau et la médecin Jade Allègre d’avoir partagé leurs recherches et travaux car, mis à part une transmission ancestrale qui devrait avoir notre considération, il existe encore peu d’études sur le sujet, ce qui fait d’elle un remède encore ostracisé.
COMMENT CHOISIR SON ARGILE ?
Les argiles sont composées majoritairement de silicate d’alumine et contiennent de nombreux minéraux comme la silice, l’alumine, le fer, le magnésium, le calcium, le sodium, le potassium, le titane, le phosphore, et des traces de métaux rares. Il existe différentes espèces minérales argileuses : smectite, kaolinite, illite, attapulgite, sépiolite etc. On en trouve des blanches, jaunes, vertes, grises comme des rouges. Elles ont chacune des propriétés différentes, en fonction du type d’affection mais aussi du tempérament de la personne. Un certain type d’argile peut avoir des résultats impressionnants chez une personne et peu de résultats chez une autre. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à tester plusieurs types d’argiles jusqu’à trouver celle qui nous convient. On peut la tester en l’appliquant sur les zones qu’on veut traiter ou en observant ses effets en la mangeant. On peut aussi très bien goûter les différentes argiles, et y aller à l’instinct, en choisissant celle qui nous attire le plus à l’odeur et au goût. Mais dans tous les cas, l’argile agit toujours. S’il y a peu de résultats, c’est que l’argile choisie opère plus lentement. On observe d’ailleurs dans la nature, que les géophages choisissent spécifiquement les terres qu’ils consomment, n’hésitant pas à parcourir des kilomètres même s’il y a des gisements plus proches¹. En effet, les humains et les animaux ont une affinité plus particulière pour les terres composées d’argiles retravaillées par les insectes ou les oiseaux car elles sont non seulement plus concentrées en minéraux mais elles ont aussi une forme plus assimilable (argile des nids de termites, argile des nids de fourmis coupeuses de feuilles, argile des nids de guêpes²).
UTILISATION EN USAGE EXTERNE
L’argile a des propriétés d'absorption (les molécules pénètrent à l’intérieur de l’argile) et d’adsorption (les molécules se fixent sur la surface de l’argile). C’est la raison pour laquelle elle est couramment utilisée en usage externe, on parle alors de « cataplasme d’argile » lorsque l’argile est appliquée sur la peau à des fins thérapeutiques.
Comment préparer son cataplasme ? Disposez une bonne quantité d’argile sèche (en poudre ou concassée) dans un récipient non métallique, puis versez une eau non bouillie et la plus saine possible à votre disposition jusqu’à ce que l’argile soit à peu près recouverte. Mélangez et laissez ensuite l’argile absorber l’eau jusqu’à ce qu’elle devienne une p'te humide et grasse. Placez ensuite une bonne épaisseur de votre préparation sur les parties choisies de votre corps. Le cataplasme est à laisser jusqu’à ce que l’argile commence à sécher, ensuite il est à renouveler plusieurs fois par jour si besoin.
L’argile a un pouvoir cicatrisant démontré. Elle est donc très bienvenue en cas de brûlures, de coupures, et affections de la peau et des muqueuses.
Traditionnellement, l’argile est appréciée pour faire cesser les saignements car les argiles telles que les kaolinites, smectites et attapulgite stimuleraient les facteurs de coagulation³. Pour cela, on saupoudre abondamment la plaie directement avec de l’argile en poudre.
L’argile va également traiter les inflammations et les rhumatismes. Mélangée à du vinaigre, il y a production d’acétate d’alumine, connue pour traiter les inflammations. En cas d’abcès ou de ganglions très enflammés par exemple, vous pouvez appliquer une bonne dose d’argile froide mélangée à du vinaigre ou bien saupoudrée de sel fin que vous mettrez en contact avec la zone à drainer.
Dans l’antiquité, Galien (131-201 après J.C.) témoigna de l’efficacité de l’argile mélangée au vinaigre fort pour traiter les morsures de chiens et piqûres d'animaux venimeux, les ulcères malins et les plaies qui ont du mal à cicatriser⁴. Encore aujourd’hui, elle est utilisée dans certains pays, comme au Sri Lanka, sur les morsures mortelles de serpents.
L’argile est aussi utilisée sur les fractures. La mythologie gréco-romaine veut que Héphaistos, chassé par Zeus, se fractura un membre qu’il guérit avec des argiles.
UTILISATION EN USAGE INTERNE
L’argile peut se consommer en interne sans danger : en France par exemple, une association de plusieurs milliers d’usagers préconise l’argile depuis plus de soixante ans, sans qu’aucun dommage n’ait été mis en évidence chez ces personnes.
Comment la consommer ? Disposez la quantité d’argile souhaitée dans un récipient non métallique, puis remplissez d’une eau non bouillie et la plus saine possible à votre disposition. L’idéal est de laisser reposer l’argile dans l’eau toute une nuit. Mélangez avant de consommer l’eau avec l’argile au réveil, au moment du coucher, ou bien 30 minutes avant un repas. On peut faire une cure d’argile aussi longtemps que le corps le demande. Comme l’argile a le pouvoir de drainer les déchets de l’organisme, il est préférable de la consommer par étape afin d’éviter des symptômes trop dérangeants. Ainsi, dans un premier temps, nous vous recommandons de simplement boire l’eau dans laquelle a baigné l’argile, sans ingérer cette dernière déposée au fond du récipient. Pour un adulte, il est aussi conseillé de commencer par une cuillère à café par jour, puis il est possible d’augmenter progressivement la dose, sachant que certains peuples sont capables d’en consommer 1 à 2 kilo(s) par jour !
L’argile a le pouvoir d’absorber et d’adsorber les toxines et les polluants qui pourraient nous empoisonner. Prise en interne, elle a la capacité d’éliminer les substances toxiques de la nourriture ingérée⁵ et de réduire la biodisponibilité des alcaloïdes et des tanins présents dans certains aliments, ces derniers étant responsables de la mauvaise digestion des protéines⁶. Les paysans Quechuas de la région de Puno, au Pérou, agrémentent leurs pommes de terre d’une p'te d'argile, ce qui adsorbe une partie des glyco-alcaloïdes ou solanine⁷, ces derniers étant des substances potentiellement toxiques, notamment en cas de consommation importante. Au 16e siècle, Wendel Thumblardt se proposa comme cobaye pour tester les qualités antipoison de l’argile. Les médecins lui administrèrent devant huissier environ 7 grammes de mercure (soit plus de onze fois la dose mortelle), puis environ 4 grammes d’argile (Terra Sigillata) et il survécut⁸. De nos jours, le Dorosz, guide pratique des médicaments, préconise l'administration d'argiles montmorillonites calciques dans le traitement de l'intoxication au paraquat (herbicide)⁹. Elles piègent aussi certains pesticides¹⁰ et la strychnine (poison de la fameuse « mort aux rats »)¹¹.
On observe que de nombreux peuples utilisent traditionnellement l’argile pour ses propriétés antiparasitaires¹². Elle semble très efficace contre certains parasites, tels que les ankylostomes et les bilharzies¹³. Selon ses observations, Jade Allègre ajoute qu’elle est aussi très efficace contre les oxyures, l’Entamoeba histolytica (amibiase intestinale) et les cryptosporidies mais ne l’est pas contre d’autres, tels que l’ascaris, les trichocéphales, Taenia saginata, Giardia intestinalis, Trichomonas, Chilomastix.
Elle a des propriétés antiseptiques, mais à la différence des antiseptiques chimiques, son caractère vivant lui permet de cibler et neutraliser uniquement ce qui est indésirable. Certaines argiles tuent de nombreuses bactéries (Staphlococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimmurium) y compris des bactéries résistantes (E. coli, Staphylococcus aureus résistant à la méticilline), d'autres non¹⁴. L’espèce argileuse smectite, quant à elle, réduit l'adhésion d’Helicobacter pylori à la surface épithéliale¹⁵.
L’argile agit également comme un pansement protecteur et apaisant pour divers troubles digestifs : diarrhée (de bénigne à grave), ulcère, gastro-entérite, hernie hiatale, dysenterie, agression parasitaire, intoxication, colopathie fonctionnelle, colite ulcéreuse et maladie de Crohn¹⁶. Beaucoup de médicaments fréquemment utilisés aujourd’hui pour les troubles digestifs sont faits à partir d’argile, comme le célèbre Smecta® (à base d’argile smectite) indiqué pour le traitement des diarrhées aiguës à chroniques. Elles soulagent aussi l’acidité gastrique car toutes les argiles sont avides de protons H+ et adsorbent donc l'acide chlorhydrique in vitro. Les smectites quant à elles s’avèrent efficaces pour réduire l'hydrogène émis lors de fermentations coliques, et par conséquent la flatulence et les ballonnements intestinaux¹⁷. On observe également chez elle un effet bactériostatique sur la toxine cholérique¹⁸, c’est pourquoi elle est utilisée pour le choléra dans de nombreux pays. Pour un adulte, 3 grammes d’argile pourraient d’ailleurs couvrir l'ensemble de la zone de son intestin grêle, mais il semblerait qu’en cas d’affection, une dose d’au minimum 6 grammes trois fois par jour soit nécessaire pour voir son efficacité.
D’autre part, on observe que l’argile agit positivement sur les carences, en faisant remonter chez certaines personnes les niveaux de fer et de globules rouges. Des études démontrent que le fer des argiles smectites peut être partiellement assimilé par l'organisme, puisque son consommateur voit sa teneur sanguine en fer augmenter suite à l’ingestion de ces minéraux ¹⁹. Les argiles rouges sont généralement plus riches en fer. Mais l’argile n’apporte pas toujours directement les substances qui sont en carence, cela tiendrait au fait que l’argile stimulerait les organes déficients et améliorerait la fonction assimilative.
L’argile est également beaucoup appréciée des femmes enceintes. Dans l’Ouest du Kenya par exemple, plus de la moitié des femmes enceintes consomment de l’argile au moins pendant les trois premiers mois ²⁰. Beaucoup d’entre elles disent en consommer pour que la grossesse se passe bien, pour éviter les nausées, les vomissements et les sensations de brûlure provenant du creux de l'estomac, pour que le bébé ait des os du cr'ne solide et le fortifier. En période d’allaitement, l’argile contribuerait à nettoyer le corps de la mère de nombreuses toxines, ce qui permet d’éviter une élimination de ces dernières par le lait maternel.
Autres usages : la syphilis, la gonorrhée, les hémorroïdes, les cystites (voie interne + petit morceau d'argile de 1/2 à 1 cm dans le vagin) , les épilepsies, la lèpre...
LES CONTRE-INDICATIONS
Les argiles sont déconseillées par voie interne en cas d’insuffisance rénale grave, de cas antécédents d’occlusion, et de maladies comportant un risque d’occlusion du tube digestif. Il est déconseillé de prendre de l’argile dans le cas de traitement médical, afin d’éviter toute interaction. Autrement, la prise de médicaments est à privilégier au moins une demi-heure avant l’ingestion d’argile.
ALIMENT DE SECOURS EN CAS DE PÉNURIE ALIMENTAIRE
En 1800, l’explorateur Alexandre de Humbolt rencontra le Frère Ramon Bueno qui avait vécu pendant 12 ans avec le peuple Ottomaque sur les rives de l'Orénoque en Colombie. Ces autochtones consommaient plusieurs centaines de grammes d’argile pendant les deux à trois mois de disette annuelle, lorsque la rivière était en crue, et qu’ils ne pouvaient pas attraper les tortues d'eau et les poissons qui constituaient l’essentiel de leur nourriture¹. Plus récemment encore, Jade Allègre visita elle-même le peuple Ottomaque de l’Amazonie colombienne et leur posa la question “Que faites-vous lorsqu’il n’y a rien à manger ?”. Ils répondirent “Nous mangeons les nids de termites (composé d’argiles), et nous essayons de trouver un peu de miel sauvage”. Elle eut également confirmation que la terre était aussi l’aliment de secours principal en Chine comme en Europe en temps de famine. L’argile constitue donc un aliment de secours intéressant en cas de pénurie alimentaire ! Attention toutefois : si elle représente une aide précieuse en terme d’optimisation d’une faible quantité de calories disponibles, elle n’est pas en elle-même suffisamment nourrissante, et ne peut donc pas représenter un aliment de substitution.
Source¹ : Alexander von Humbolt (1848) Tableaux de la Nature, traduction Eyriès, I, p 191-211
Cet article a été rédigé par Estelle Sovanna et il est issu du magazine Régénère n°7 "De la crise à l'autonomie".