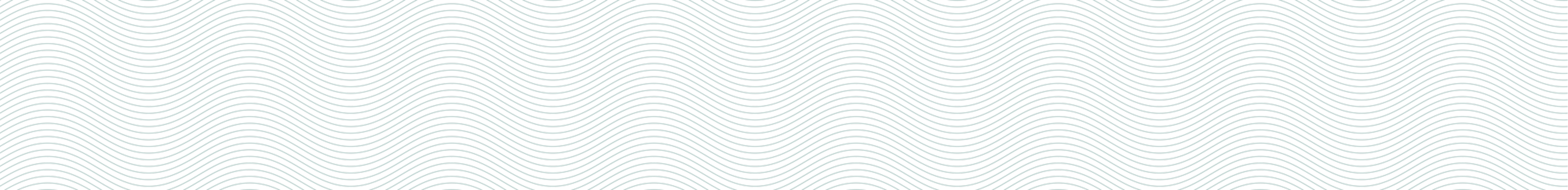Durant l'année, il y a des mois d'abondance, voire de surabondance, et des mois de disette. C’est la raison pour laquelle l’humain a cherché très tôt à conserver ses denrées alimentaires. Aujourd’hui, la nécessité d’apprendre à conserver nos aliments est moins impérieuse car nous pouvons les importer de l’autre bout de la planète et les conserver au froid durant de longues périodes. Il est important de se rappeler que tout ceci n'est possible qu'au prix d'une très grande dépense (et donc dépendance) énergétique. À la moindre crise majeure, tout ceci peut s'arrêter du jour au lendemain. Découvrons à nouveau les techniques traditionnelles de conservation, les avantages et les limites de chacune.
LA PASTEURISATION ET LA STÉRILISATION
La pasteurisation et la stérilisation sont des techniques de conservation qui utilisent des températures très élevées. Les hautes températures vont avoir pour conséquence de détruire tous les micro-organismes présents dans le milieu afin de le rendre stérile. Pour cela, on utilise deux procédés : la pasteurisation, qui s’effectue en dessous des 100 °C (entre 60 °C et 95 °C), et la stérilisation, qui dépasse les 100 °C (entre 116 °C et plus de 140 °C). La stérilisation détruit davantage les micro-organismes que la pasteurisation car elle détruit aussi les spores (la spore est une sorte de « graine ». Sous cette forme, la bactérie peut résister à des conditions beaucoup plus extrêmes que la bactérie « vivante ».). Ainsi les contenants stérilisés pourront se conserver plusieurs années alors que les contenants pasteurisés auront un temps de conservation de plusieurs mois. Ces méthodes de conservation ont l'avantage de permettre une longue conservation des aliments sans dépendance énergétique. Par contre, elle présente l'inconvénient majeur de dégrader le contenu micro nutritionnel, cette dégradation étant plus importante par la stérilisation que par la pasteurisation. De plus, les contenants stérilisés ou pasteurisés vont, une fois ouverts, se dégrader très rapidement car les micro-organismes de l'environnement vont trouver un espace vierge à coloniser. Un autre inconvénient de cette méthode tient à la nécessité absolue de maintenir l'étanchéité des contenants car à la moindre fuite, tout est perdu.
LA RÉFRIGÉRATION ET LA CONGÉLATION
La réfrigération et la congélation sont des techniques de conservation qui utilisent des températures très basses. Les basses températures vont contrôler le développement des micro-organismes car plus la température baisse, plus le métabolisme et l'activité des micro-organismes responsables de la dégradation sont ralentis. L'avantage de cette méthode est que le produit est peu dégradé par le traitement thermique : il garde l’essentiel de son contenu micro-nutritionnel et de son contenu microbien. Par contre, l’inconvénient tient à la dépendance énergétique : sans électricité nous perdons tout ! Le second inconvénient de la congélation est l'altération de la texture des aliments conservés. Une fois décongelés, ils se gorgent d’eau et deviennent moins appétissants.
LA MISE SOUS VIDE
La mise sous vide est une technique de conservation qui utilise le retrait de l’air des contenants. L’absence d’air permet de ralentir d’une part le développement des micro-organismes dont la prolifération est une des causes de l’altération du produit, et d’autre part les réactions d’oxydation, également à l’origine de la dégradation du produit. L’avantage de cette méthode est qu’elle ne dégrade ni le contenu micronutritionnel, ni la texture du produit. L’inconvénient c’est qu’elle demande un peu d'énergie, notamment pour la pompe à vide d'air, et des contenants spécifiques à la mise sous vide. De plus, le seul fait d'enlever l'air ne suffit pas à stopper complètement l'activité des micro-organismes et si la mise sous vide n'est pas couplée à un séchage préalable, elle ne peut qu'être un moyen de conservation à court terme. Ceci est d'autant plus vrai que le produit est riche en eau.
LA DÉSHYDRATATION ET LE SÉCHAGE
La déshydratation et le séchage sont des techniques de conservation qui utilisent le retrait de l’eau des produits alimentaires. En effet, les micro-organismes ont besoin d'eau pour prospérer. Sans eau, leur activité ralentit, voire s’arrête complètement et permet ainsi le ralentissement de la dégradation du produit. Déshydrater un produit revient à extraire toute l'eau de ce produit pour obtenir un produit quasi impérissable. De surcroît, si le séchage se fait vraiment à une température inférieure à 40 °C, alors l’aliment va garder la qualité et la quantité de son contenu nutritionnel ainsi que son stock enzymatique, puisque la dégradation liée à l'oxydation est relativement faible. La texture du produit est altérée mais il peut être réhydraté, offrant des résultats très appréciables. Le grand avantage est que nous pouvons sécher ou déshydrater nos aliments simplement avec le soleil, en laissant sécher les aliments sur des claies ou en les suspendant à un fil. Nous pouvons aussi opter pour le déshydrateur électrique qui va permettre de contrôler précisément le temps et la température de séchage. Ces déshydrateurs sont certes très pratiques mais dépendant de l'électricité, facteur à prendre en compte dans une logique d'autonomie. Il existe aussi des déshydrateurs solaires auto-construits mais par expérience, il est très difficile de contrôler l'élévation de température avec ces modèles. Une fois bien secs, les produits sont très stables en termes de conservation. Attention toutefois aux petits prédateurs (mites, souris, rongeurs et insectes divers) qui peuvent détruire vos stocks en quelques jours ! C'est pourquoi il est judicieux de stocker les produits secs dans des contenants bien étanches ou, mieux encore, de les mettre sous vide.
LE SALAGE
Le salage est une méthode de conservation qui utilise le sel à la surface des aliments. Saler un produit en surface permet d’extraire en partie l’eau des aliments qui va être absorbée par le sel. De plus, le sel va permettre de mieux contrôler les développements microbiens en début de séchage et de neutraliser les micro-organismes pathogènes. Généralement on couple le salage au séchage pour plus de sécurité.
LA FERMENTATION LACTIQUE
La fermentation lactique, appelée communément “lacto-fermentation”, est une méthode de conservation très ancienne qui, en l’absence d’air, utilise la prolifération de bactéries spécifiques que l’on appelle bactéries lactiques. Les ferments lactiques se développent en anaérobie, c’est-à-dire en l’absence d’air. C’est pourquoi, lors d’une lacto-fermentation, il est nécessaire d’immerger totalement les aliments dans de la saumure qui est une solution aqueuse salée (environ 30 g de sel par litre avec un sel le moins raffiné possible), ou de compacter les produits au maximum afin d'évacuer le plus d'air (comme pour le saucisson). Les bactéries lactiques doivent être très actives, envahir rapidement le milieu, le transformer et le rendre inhospitalier à la concurrence. C'est une course contre la montre car soit les bactéries lactiques prédominent, soit ce sont les agents pathogènes ou les micro-organismes responsables du pourrissement ou de la putréfaction qui prennent le dessus. Le produit est alors perdu. Si la lacto-fermentation est réussie, alors le liquide devient de plus en plus acide, prenant la saveur du vinaigre. Lorsqu’il atteint l’acidité idéale (pH 4), les bactéries lactiques sont elles-mêmes inhibées et la préparation se stabilise pour une longue conservation. La méthode classique consiste à plonger les aliments, entiers ou découpés, dans une saumure, et s'assurer que les aliments soient bien immergés. Certaines lacto-fermentations se font hors saumure comme le saucisson ou certaines préparations de lait. Pour ces derniers, il faut s'assurer que le produit soit le moins possible au contact avec l’air en compactant au maximum la chair à saucisse afin de réaliser le saucisson. La fermentation lactique a non seulement l’avantage de conserver le contenu micro nutritionnel mais, plus encore, de l'enrichir par le travail de pré-digestion des bactéries lactiques qui augmentent la biodisponibilité des nutriments, l'apport d'enzymes et de vitamines supplémentaires issus directement de la fermentation. À condition de disposer d'une eau pure et d’un sel de qualité, elle figure certainement parmi les meilleures méthodes de conservation dans une logique d'autonomie.
LA FERMENTATION ALCOOLIQUE
La fermentation alcoolique est une méthode de conservation qui, en l’absence d’air, utilise les levures naturellement présentes ou celles que l’on ajoute. Les levures vont consommer le sucre qu’elles vont rejeter en alcool pour moitié et en gaz carbonique pour autre moitié. L’alcool rend le milieu inhospitalier à de nombreuses bactéries, hormis les bactéries acétiques. La limite de ce mode de conservation va résider dans la capacité de l'organisme à tolérer l'ingestion d’alcool, mais aussi la nécessité de garder le produit complètement à l'abri de l’air. Autrement, il se produira une colonisation par les bactéries acétiques, ce qui aboutira à la fermentation acétique que nous allons voir ci-après.
LA FERMENTATION ACÉTIQUE
La fermentation acétique est une méthode de conservation qui, en présence d’air, utilise la prolifération de bactéries spécifiques que l’on appelle bactéries acétiques. Ces dernières vont se développer dans un milieu alcoolisé où toutes les autres bactéries ont dû mal à survivre. En effet, la fermentation acétique vient toujours en second lieu : elle se produit dans un milieu qui a d’abord fermenté avec des levures, donc dans un milieu alcoolisé, ce qui constitue la fermentation alcoolique précédemment citée. Puis au contact de l’air, on assiste à une colonisation par les bactéries acétiques qui vont venir transformer l’alcool. La fermentation acétique va alors donner du vinaigre, dont le goût est assez proche de celui obtenu par lacto-fermentation, sans toutefois présenter les mêmes qualités sur le plan nutritionnel. La fermentation acétique permettra donc une assez bonne conservation des aliments car les sucres sont consommés par les bactéries acétiques au détriment des autres organismes dégradateurs, mais elle ne présentera pas l'équivalent des qualités de la lacto fermentation.
Cet article a été rédigé par Thierry Casasnovas et Estelle Sovanna et il est issu du magazine Régénère n°7 "De la crise à l'autonomie".